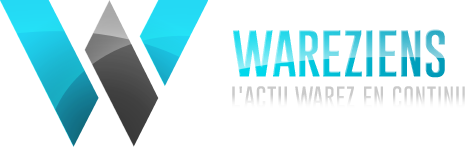Je vous partage un article qui est assez intéressant, sur le traitement médiatique des supposées ingérences russes, établit comme un fait par beaucoup et qui ne repose toujours sur aucune preuve concrète autre que des on dits et le renseignement américain(bien connu pour son amour pour la vérité) qui affirme sans prouver.
(Article écrit par Aaron Maté, journaliste, et publié dans le Monde Diplomatique de ce mois)
Depuis l’élection présidentielle, pas un jour ne s’écoule sans que la question de l’ingérence prêtée à Moscou dans les affaires intérieures américaines et de la collusion entre l’entourage de M. Donald Trump et celui de M. Vladimir Poutine n’agite la classe politique et les grands médias. Aux États-Unis et ailleurs. Les responsables du renseignement américain soutiennent que le gouvernement russe aurait piraté des courriels et manipulé les réseaux sociaux dans le but de favoriser l’élection de M. Trump. Le rapport du directeur du renseignement national (DNI) de janvier 2017, abondamment cité, contient certes des « formules-chocs et l’évaluation la plus détaillée du dossier d’accusation », mais il ne fournit pas la « moindre preuve », ainsi que le souligne le mensuel The Atlantic (janvier 2017), pourtant bien en vue dans le camp antirusse. Tout aussi militant sur ce terrain, le New York Times (6 janvier 2017) s’étonne de l’« absence d’éléments susceptibles d’étayer les griefs des agences de renseignement ». Et il note que le message lancé par ces dernières « se résume à : “Faites-nous confiance” ». Un constat que rien n’est venu démentir pour le moment.
Il en va de même au sujet du soupçon de collusion. Les enquêteurs ont reconnu en mai dernier qu’ils n’avaient « pu constater aucun délit ou lien de collusion entre la campagne électorale et la Russie dans les échanges examinés à ce jour (1) ». Et, plus récemment, des personnalités pourtant hostiles à M. Trump — dont l’ancien DNI James Clapper, l’ancien directeur de l’Agence centrale de renseignement (CIA) Michael Morell ou la sénatrice démocrate Dianne Feinstein — ont fait état de la même impasse.
Prendre en considération cette absence de preuves permet de mieux comprendre ce qui les remplace. Les auteurs de Shattered, un ouvrage d’enquête consacré aux coulisses de la campagne de Mme Hillary Clinton, relatent que, dans les jours qui ont suivi le scrutin, l’égérie du Parti démocrate a refusé d’assumer « la responsabilité de l’échec de sa candidature ». Selon une source citée dans l’ouvrage, sa stratégie pour y parvenir a consisté à « s’assurer que les éléments de langage appropriés seraient correctement diffusés ». Ainsi, vingt-quatre heures à peine après que Mme Clinton eut reconnu sa défaite, divers hauts responsables « se réunissaient pour s’accorder sur l’idée que quelque chose clochait dans cette élection ». Déjà, ajoutent les auteurs, la thèse d’une ingérence russe était au cœur de leur risposte (2). La candidate démocrate y consacre d’ailleurs un chapitre de cinquante pages dans son dernier livre, paru en septembre (3).
Thriller d’espionnage
La focalisation sur Moscou ne joue pas seulement en faveur du camp Clinton. Elle coïncide également avec les intérêts de la fraction de l’appareil d’État qui rejette la perspective, longtemps défendue par M. Trump, d’une amélioration des relations entre Moscou et Washington, et qui agite les épouvantails de la guerre froide pour y faire obstacle (4). Les enquêtes à répétition et les fuites anonymes constituent aussi un moyen de réfréner les dispositions prêtées à un président fantasque dont la rhétorique anti-interventionniste — de toute évidence une ruse électorale — a effrayé les pontes de la diplomatie américaine tout au long de la campagne présidentielle. Avide de clics et d’audience, l’industrie des médias a quant à elle flairé l’aubaine : un thriller d’espionnage digne de Hollywood, d’autant plus séduisant aux yeux d’une partie du public qu’il entretient son espoir de voir le président honni frappé de destitution.
La combinaison de ces facteurs explique que, dans l’affaire du « Russiagate », les règles élémentaires du travail journalistique soient traitées avec une franche désinvolture. On reprend telles quelles des informations non vérifiées, on isole et dramatise les éléments qui vont dans le bon sens tandis que l’on minore ou ignore les autres. Bien souvent, les rebondissements croustillants annoncés en « une » se révèlent beaucoup moins spectaculaires, voire inexistants, sitôt qu’on lit l’article qui s’y rapporte. À défaut de sources fiables et de faits établis, on colmate alors les brèches à coups de tournures hypothétiques — « il semble que », « on ne serait pas surpris si », « sans doute », « probablement » — et de conditionnels.
Accueillis initialement comme parole d’évangile, nombre de récits qui ont accrédité la thèse d’une collusion entre le Kremlin et l’équipe de campagne du candidat républicain mettent à présent en danger ce fragile édifice narratif. On a amplement glosé par exemple sur la lettre d’intention dans laquelle le candidat républicain, au beau milieu de sa campagne, proposait aux dirigeants russes de construire une tour Trump à Moscou. L’intermédiaire choisi pour cette négociation, le promoteur — d’origine russe — Felix Sater, eut l’imprudence de certifier à l’avocat de M. Trump, M. Michael Cohen, qu’une telle opération aiderait le milliardaire à remporter l’élection. « Je vais mobiliser Poutine sur ce projet et on va faire élire Donald Trump », plastronnait ainsi M. Sater dans un courriel, avant de préciser ce qu’il entendait par là : selon lui, les électeurs ne pourraient qu’admirer la capacité de M. Trump à conclure une affaire immobilière avec l’« adversaire le plus coriace » des États-Unis.
Toutefois, le New York Times (28 août 2017) devra l’admettre, « rien ne prouve que les promesses de M. Sater aient été suivies d’effet. Un courriel suggère d’ailleurs qu’il a exagéré ses liens avec la Russie. En janvier 2016, M. Cohen écrit au porte-parole de Vladimir Poutine, Dmitri S. Peskov, pour le prier de réactiver le projet de tour Trump, resté en suspens. Mais M. Cohen ne semblait pas avoir l’adresse électronique de M. Peskov, puisqu’il a envoyé son courriel à une adresse collective destinée aux demandes de presse. Le projet n’a jamais reçu d’autorisation gouvernementale ni de financement, et fut abandonné quelques semaines plus tard ».
De son côté, M. Peskov assure avoir fini par prendre connaissance du courriel de M. Cohen, mais ajoute qu’il n’y a pas répondu. L’histoire aurait justifié le soupçon d’un conflit d’intérêts, M. Trump étant accusé d’avoir cherché à négocier l’extension de son empire immobilier en Russie au moment précis où il chantait les louanges de M. Poutine dans ses meetings. On voit mal cependant en quoi un contrat qui n’a jamais vu le jour serait plus digne de considération que ceux, bien réels, qu’a décrochés M. Trump en Turquie, aux Philippines ou dans le golfe Arabo-Persique.
La divulgation des courriels adressés par M. Sater à M. Cohen faisait suite à une autre révélation : un ancien journaliste britannique, Rob Goldstone, a envoyé en juin 2016 au fils aîné de M. Trump des documents compromettants sur Mme Clinton, afin, disait-il, d’assurer ce dernier du « soutien de la Russie et de son gouvernement ». Le courriel de Goldstone s’est avéré plus concluant que celui de M. Sater, puisqu’il a débouché sur une rencontre avec M. Donald Trump Jr., dont celui-ci prétend qu’il y a mis fin au bout de vingt minutes. Forfaiture ? Les états de service des deux expéditeurs permettent d’en douter : M. Sater est connu comme un « bonimenteur haut en couleur (5) » qui, pour nuire à d’anciens partenaires d’affaires, a lancé sur Internet des sites aux noms aussi poétiques que IAmAFaggot.com et VaginaBoy.com (6). Quant à M. Goldstone, il a travaillé pour des tabloïds anglais de seconde zone avant de se reconvertir dans les relations publiques d’artistes de variété. Inutile d’être un expert du renseignement pour douter de la proximité de ces deux personnes avec le Kremlin.
Des questions du même ordre se posent au sujet de la mise en examen, le 30 octobre dernier, de M. George Papadopoulos, un ancien conseiller en politique étrangère — mais de rang subalterne — au sein de l’équipe de campagne de M. Trump. On lui reproche d’avoir menti au Bureau fédéral d’enquête (FBI) à propos de ses contacts avec des individus liés au Kremlin. M. Papadopoulos a plaidé coupable. Toutefois, la ressortissante russe qu’on lui aurait présentée comme la « nièce » de Poutine n’avait strictement aucun rapport avec celui-ci (il n’a pas de nièce). Elle s’appellerait Olga Polonskaya et aurait exercé la fonction de cadre supérieure dans une société de distribution de vins.
Et pendant l’élection allemande ?
En outre, l’ancien conseiller évoque l’existence d’un homme supposé être un proche du ministre des affaires étrangères russe avec qui il aurait également été en rapport. Cet homme, M. Ivan Timofeev, diplômé de l’Institut d’État des relations internationales de Moscou, a expliqué au FBI qui l’interrogeait : « À un moment donné, [Papadopoulos] m’a demandé s’il serait possible d’arranger une rencontre entre Trump et Poutine, ou avec un autre dirigeant politique russe de haut niveau. Au fil de notre conversation, il m’est apparu que George ne connaissait pas grand-chose au monde de la diplomatie russe. Vous ne pouvez pas débarquer comme ça pour fixer un rendez-vous avec le président, par exemple (7). »
Une autre révélation a fait sensation, aux États-Unis et en Europe. Selon Facebook, des centaines de faux comptes « probablement créés en Russie » ont dépensé 100 000 dollars pour diffuser près de trois mille annonces entre juin 2015 et mai 2017 — une campagne aussitôt qualifiée par le New York Times (8 septembre 2017) de « preuve supplémentaire d’une intrusion étrangère sans précédent dans la démocratie américaine ». A-t-elle produit pour autant un impact digne de la place que les médias lui ont consacrée ? Si l’on compare cette somme de 100 000 dollars (85 000 euros) aux 6,8 milliards de dollars de dépenses de campagne électorale en 2016, il est permis d’en douter. D’ailleurs, d’après Facebook, « la grande majorité de ces messages publicitaires ne faisaient référence ni à l’élection présidentielle américaine ni à un candidat particulier », mais visaient plutôt à « exacerber les divisions sociales et politiques du pays, sur l’ensemble de son spectre idéologique et sur des sujets aussi variés que les droits des lesbiennes, gays, bi et trans (LGBT), le racisme, l’immigration ou le port d’armes ». Le mastodonte des réseaux sociaux assure en outre que 56 % de ces annonces ont été consultées « après l’élection ».
De nombreux commentateurs ont vu dans cette campagne la main du Kremlin. Selon le Washington Post (24 septembre 2017), qui a publié l’enquête la plus exhaustive à ce propos, « il semble que les publicités aient été diffusées par des comptes associés à l’Internet Research Agency », une officine de propagande en ligne inféodée au gouvernement russe. Cependant, et toujours selon le Washington Post, une première enquête de Facebook a fait apparaître que ces comptes présumés russes « poursuivaient des objectifs clairement financiers, ce qui semble suggérer qu’ils n’étaient pas au service d’un gouvernement étranger ». Néanmoins, les automatismes propres au « Russiagate » imposent de remplacer les démonstrations défectueuses par des certitudes, comme dans cette phrase extraite de l’enquête du Washington Post : « La sophistication tactique des Russes a pris Facebook au dépourvu. »
Plus loin, le même quotidien détaille en quoi consiste cette « sophistication » : « Pendant que Facebook s’affairait à chercher des preuves d’une manipulation russe, cette hypothèse ne cessait de gagner des adeptes au sein des cercles influents. Dans la tension des lendemains de l’élection, des conseillers de Hillary Clinton et de Barack Obama avaient la tête plongée dans les études d’opinion et les sondages postélectoraux, à la recherche d’indices pouvant expliquer ce qu’ils considéraient comme un résultat totalement anormal. L’une des théories qui émergèrent de leur trauma post mortem a consisté à dire que des “trolls” russes téléguidés par le Kremlin avaient utilisé Facebook et d’autres réseaux sociaux pour influencer les électeurs américains dans les États-clés et modifier ainsi le rapport de forces en faveur de Trump. Ces conseillers n’avaient pas l’ombre d’une preuve pour étayer leur théorie, du moins à l’époque, mais ils la jugeaient suffisamment attrayante pour la faire partager aux commissions parlementaires enquêtant sur les services secrets. (…) En mai, au cours d’une visite au siège de Facebook, le sénateur démocrate Mark Warner, vice-président de la commission sénatoriale chargée des renseignements, “encouragea la compagnie à procéder à quelques changements dans sa façon de conduire ses enquêtes internes”. En annonçant en août avoir débusqué trois mille messages publicitaires “ vraisemblablement” russes, Facebook a relancé le scandale et s’est retrouvé convoqué devant plusieurs commissions du Congrès. »
Aucun scrutin ne paraît à l’abri du péril russe. Le 1er septembre 2017, le New York Times publie en « une » un article titré « Les opérations russes de piratage des élections plus étendues que prévu, mais toujours aussi peu surveillées ». Dans le corps de l’article, nul indice factuel d’un piratage quelconque, mais un lot d’accusations mal étayées qui déçoivent le lecteur alléché par l’odeur du scoop. À propos d’irrégularités constatées lors de l’élection en Caroline du Nord, le journal rapporte le commentaire d’une observatrice qui aurait « eu l’impression d’une altération, ou d’une sorte de cyberattaque ». « Des mois plus tard, poursuit le journal, on s’interroge encore sur ce qui s’est passé ce jour-là en Caroline du Nord, en Virginie, en Géorgie et en Arizona. » L’auteur de l’article admet toutefois : « Bien d’autres raisons pourraient expliquer ces irrégularités — des responsables locaux ont pointé des erreurs humaines et des dysfonctionnements informatiques —, et à ce jour il n’existe aucune preuve indiscutable d’un sabotage numérique, encore moins d’une implication russe. » Quelques jours après, la hantise d’un piratage par Moscou s’amplifie néanmoins quand le ministère de la sécurité intérieure (DHS) prévient vingt et un États qu’ils pourraient avoir été la cible d’une cyberattaque russe pendant le scrutin de novembre 2016. Trois États réfutent cette hypothèse, parmi lesquels la Californie, qui annonce fin septembre qu’à l’issue de ses propres investigations il est « clair que les conclusions du DHS étaient erronées ».
Les dernières élections en France et en Allemagne ont vu se déployer des craintes similaires, parfois suivies des mêmes résultats. En France, les soupçons de piratage russe ont défrayé la chronique au point d’inciter l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) à publier une mise au point. Durant la campagne électorale, une cyberattaque a certes visé En marche !, le mouvement de M. Emmanuel Macron, mais elle « était si générique et si simple qu’elle pourrait être l’œuvre de presque n’importe qui », estima en juin dernier le directeur général de l’ANSSI, qui ajouta qu’« aucune trace » ne permettait d’incriminer Moscou (8). En Allemagne, l’épisode électoral s’est avéré encore plus frustrant pour les amateurs de complot russe : il ne s’est rien passé du tout. « L’absence apparente d’une campagne russe visant à saboter l’élection allemande est un casse-tête pour les dirigeants et les experts qui avaient mis en garde contre une probable offensive de ce type », rapporte alors, décontenancé, le Washington Post (10 septembre 2017) dans un article titré : « Alors que les Allemands se préparent à voter, le mystère grandit : où sont les Russes ? » Quelques jours plus tard, le New York Times (21 septembre 2017) s’étonne lui aussi : « Le mystère de l’élection allemande : pourquoi les Russes ne sont-ils pas intervenus ? »
Vieilles ficelles maccarthystes
À en juger par la dernière consultation au Royaume-Uni, le mystère n’est pas près d’être levé. Plus d’un an après que les électeurs eurent voté, par une majorité de 1 300 000 voix, pour le Brexit, le spectre du grand « troll » russe continue de hanter les esprits. Le 12 novembre dernier, dans un éditorial du quotidien iNews titré « Nous avons besoin d’une enquête sur le rôle de la Russie dans le Brexit », le journaliste Ian Birrell présume qu’il « serait surprenant que la Russie n’ait pas tenté de s’immiscer dans notre référendum, compte tenu du mépris de Poutine pour les alliances occidentales les plus stratégiques telles que l’Union européenne ou l’Organisation du traité de l’Atlantique nord [OTAN] ». Des députés britanniques ont repris la balle au bond en faisant savoir que des comptes Twitter liés à la Russie auraient posté des messages concernant le Brexit, un rebondissement qui, selon le New York Times (3 novembre 2017), « pourrait soulever des questions quant à la validité du référendum » lui-même. « Mon message à la Russie est très simple, a embrayé la première ministre britannique Theresa May le 13 novembre dernier. Nous savons ce que vous faites et vous ne réussirez pas. » Selon Laura Cram, directrice de recherche à l’université d’Édimbourg, qui a dénombré 419 comptes concernés, « environ 78 % des messages ont été envoyés après le vote sur le Brexit du 23 juin 2016 (9) ».
Nul ne sera surpris que la crise catalane ait été, elle aussi, imputée à la Russie, le gouvernement espagnol et l’Union européenne ayant l’un et l’autre accusé le Kremlin d’avoir manipulé la consultation populaire sur l’indépendance de la région. « Référendum en Catalogne : la Russie a gagné », a réagi le Washington Post (2 octobre 2017). De son côté, El País n’a pas hésité à consacrer quatre « unes » à cette présomption d’ingérence la même semaine (10). Un chercheur de l’université George Washington avait en effet informé le quotidien de la « découverte d’une armée de comptes “zombis” » sur des réseaux sociaux liés à la Russie, destinés à « diffuser une image négative de l’Espagne dans les jours précédant le référendum [catalan] du 1er octobre ». Mais si, dans cette affaire, une image est « diffusée », c’est surtout celle de la Russie — un pays pourtant isolé, soumis à des sanctions économiques, très dépendant de ses ressources pétrolières, toujours sous le choc de décennies d’économie administrée suivies de privatisations désastreuses, et qui aurait néanmoins un pouvoir tel qu’il lui permettrait de subvertir simultanément plusieurs États plus puissants que lui.
Comme on ne prête qu’aux riches, Moscou est aussi l’objet de soupçons en dehors des élections. En août dernier, lors des violences déclenchées à Charlottesville par des suprémacistes blancs, la consultante en politique étrangère Molly McKew a lancé un appel largement repris sur Twitter : « Il faut qu’on discute de ce qui est en train de se passer aujourd’hui à Charlottesville et de l’influence et des opérations russes aux États-Unis. » Depuis, l’experte a été auditionnée par une commission du Congrès qui se consacre au « fléau de la désinformation russe ».
Sur Cable News Network (CNN), le 23 août 2017, une enseignante en droit à l’université Yale, Asha Rangappa, estime de son côté que Charlottesville « a mis en lumière le problème de la Russie ». Certes, concède-t-elle, « à ce jour il n’y a pas de preuve démontrant que la Russie soutient directement des groupes d’extrême droite aux États-Unis ». Mais — car il y a toujours un « mais » — les liens entre Moscou et l’extrême droite européenne « suggèrent que les services de renseignement russes sont prêts, pour intervenir sur le territoire américain, à utiliser des groupes qui propagent la haine ».
Quelques mois plus tôt, il était pourtant d’usage de relier les Russes au camp américain opposé. Ainsi, en mars, des membres du renseignement américain témoignaient devant le Congrès que la « cyberinvasion [russe] du xxie siècle » avait tenté de « semer la discorde aux États-Unis en attisant des mouvements de protestation comme Occupy Wall Street ou Black Lives Matter ». Pièce à conviction ? Ces deux mouvements avaient été largement couverts par la chaîne publique russe RT (ex-Russia Today) (11).
Pareilles extrapolations en disent long quant à l’état d’esprit des experts et des législateurs. Après l’affaire des trois mille annonces identifiées par Facebook, Twitter a transmis au Congrès une liste de 200 comptes « liés aux interférences russes dans l’élection de 2016 ». Sachant que Twitter totalise 328 millions de comptes, laisser entendre que 200 d’entre eux peuvent dénaturer un scrutin national insulte le sens commun autant que les mathématiques. Cela revient en outre à assimiler les manifestants de Black Lives Matter à des agents étrangers qui s’ignorent et qui, à leur insu, attendent un signal du Kremlin sur les réseaux sociaux pour se mobiliser contre le racisme existant dans leur pays.
Attribuer le militantisme noir aux États-Unis à l’influence néfaste de Moscou n’est pas un procédé nouveau. « Les rouges tentent de pousser les nègres à la révolte », titrait déjà le New York Times en juillet 1919. Dans les années 1960, les partisans de la ségrégation raciale assimilaient le mouvement pour les droits civiques à une marionnette manipulée par les Soviétiques. Le FBI justifia même la mise sur écoute de Martin Luther King par ses liens supposés avec le Parti communiste américain.
Que l’époque favorise la reprise des vieilles ficelles maccarthystes n’est pas non plus une surprise. Au plus fort de la sarabande médiatique sur les manœuvres présumées de Moscou sur les réseaux sociaux, Twitter a révélé ses nouveaux critères d’identification des comptes suspects, parmi lesquels figureront l’utilisation d’un nom en caractères cyrilliques ou des messages rédigés en langue russe… La sénatrice Dianne Feinstein a demandé par ailleurs à la même entreprise de signaler aux autorités tous les messages expédiés ou reçus par le fondateur de WikiLeaks Julian Assange et d’autres internautes considérés par elle comme proches de lui — y compris, selon M. Assange, ceux envoyés à son avocat américain.
De son côté, la représentante démocrate de la Californie Jackie Speier a appelé Google à bannir RT de sa plate-forme YouTube. Le géant de l’Internet lui ayant répondu, par la voix de son vice-président Kent Walker, qu’une enquête « minutieuse » sur RT n’avait révélé aucune violation de la politique suivie par Google « contre les discours de haine et les incitations à la violence », Mme Speier a refusé d’en démordre, arguant que la chaîne russe était une « machine de propagande » et une « arme aux mains de l’un de nos adversaires ».
Qu’importe si RT revendique moins de trente mille téléspectateurs par jour aux états-unis : sa toxicité n’en serait que plus grande, à en juger par le rapport du DNI de janvier 2017, qui accuse la chaîne d’« insister sur la critique des présumées défaillances américaines en matière de démocratie et de libertés civiles ».
Les enquêtes visant la chaîne RT et l’agence multimédia Sputnik ont accru les tensions entre Moscou et Washington. Dénonçant une « attaque » contre les médias de son pays, le président Vladimir Poutine a décidé une « riposte similaire ». Les radios Voice of America et Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), financées par le Congrès américain, mais aussi CNN International, sont désormais affublées du statut peu enviable d’« agents de l’étranger ». Cette action contre RFE/RL — fondée au temps de la guerre froide pour défier l’Union soviétique — ravive quelques souvenirs.
Les pressions qui s’exercent sur RT et Sputnik n’émanent plus seulement des milieux gouvernementaux. Au cours d’une rencontre organisée récemment par l’Atlantic Council, un think tank influent spécialisé dans les relations internationales, le journaliste James Kirchick a appelé le secteur privé à « faire honte à RT, à l’isoler et à l’expulser hors des espaces respectables de la société ». Selon lui, les « jeunes journalistes occidentaux de 22 ou 23 ans que RT cherche à recruter » y réfléchiront à deux fois « s’ils savent qu’après cela ils ne trouveront plus jamais un boulot dans un média convenable (12) ».
Une « résistance » sans risques
Parmi les Américains qui se focalisent sur le « Russiagate », beaucoup sont mus par la peur et le désarroi que leur inspire le règne du président le plus incompétent et imprévisible de l’histoire du pays. Pour d’autres en revanche, ceux notamment qui occupent une position privilégiée, c’est surtout un mode de « résistance » commode et garanti sans risques. Il permet d’éviter de s’interroger sur son propre rapport au système économique et politique contre lequel nombre d’électeurs de M. Trump se sont rebellés. Si, pour reprendre la formule de Rachel Maddow, journaliste-vedette de la chaîne MSNBC le 17 mars dernier, « la présidence actuelle est le produit d’une opération russe [et] résulte d’une collusion entre les services secrets russes et une campagne électorale américaine », alors tout devient simple : il n’y a plus rien d’autre à affronter que MM. Trump et Poutine.
Le mécontentement face aux inégalités sociales, l’encouragement à l’abstention, le désarroi du Parti démocrate concernant la ligne à tenir — autant de sujets que la fixation sur les agissements de Moscou rejette à l’arrière-plan. Les problèmes des petites gens n’ont jamais suscité la passion des médias et des élites politiques : le « Russiagate » leur permet de s’en détourner encore plus.
Comment l’obsession américaine pour les cyberattaques russes peut-elle être reçue dans les pays qui, par le passé, ont subi des ingérences autrement plus substantielles ? Selon une étude publiée fin 2016 par l’université Carnegie Mellon (Pittsburgh), les États-Unis se sont immiscés dans pas moins de quatre-vingts élections hors de leurs frontières depuis la seconde guerre mondiale — un chiffre qui ne prend pas en compte les changements de régime plus ou moins sanglants fomentés par Washington à l’étranger, comme en Iran, au Chili ou au Guatemala. Récemment encore, les autorités américaines ont favorisé le renversement d’un gouvernement démocratiquement élu en Ukraine, aux frontières de la Russie. Qu’on imagine la réaction de la Maison Blanche si surgissait un enregistrement dans lequel des dirigeants russes comploteraient pour désigner le futur président des États-Unis, ainsi que des officiels américains de premier plan l’ont fait pour le premier ministre de l’Ukraine (13).
Ces questions sont ignorées, tout comme les tensions croissantes entre la Russie et les États-Unis, en dehors bien sûr de ce « Russiagate ». Au milieu des réquisitoires assourdissants contre « Vladimir le tireur de ficelles », on en oublierait presque que M. Trump a discrètement nommé des « faucons » antirusses à des postes stratégiques et accueilli un nouveau venu, le Monténégro, au sein de l’OTAN, en dépit des préventions de la Russie. On en oublierait aussi que le commandant en chef des troupes américaines, le général Joseph Dunford, partage la volonté du Pentagone et du Congrès de fournir à l’Ukraine des armes supplémentaires. Le président Obama avait rejeté une proposition similaire, de crainte d’exacerber le conflit entre Kiev et Moscou.
Ces tensions ne peuvent que s’aggraver dans un climat politique où toute approche diplomatique du dossier russe est perçue comme une faiblesse et où la politique des sanctions et de l’escalade armée constitue l’un des rares points d’accord entre républicains et démocrates, lesquels viennent d’ailleurs de voter conjointement un budget militaire encore supérieur à celui que réclamait M. Trump. « Les inquiétudes de l’OTAN par rapport à la Russie sont considérées comme un signe positif pour l’industrie de la défense », note la presse financière (14), heureuse de constater que les cours des sociétés d’armement atteignent un « niveau historique » — tout comme d’ailleurs celui de MSNBC, la chaîne qui a le plus couvert le « Russiagate ».